Bonjour,
Sempé, un goût d’éternité: hommage de son ami Frédéric Pajak
Grand maître français de l’humour et de la poésie, mélange de dérision et de modestie, Sempé s’est éteint. Mais son dessin reste éternel, relève son ami l’écrivain lausannois Frédéric Pajak, qui lui rend un hommage tout en délicatesse.
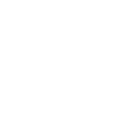
Frédéric Pajak

Sempé dans son atelier, à Paris, en 2011. Plus que tout autre dessinateur, il était régulièrement exposé dans des galeries. «Une chose le tourmentait au-delà de tout: trouver le gag, la situation drôle. Il pouvait passer des heures et des jours à attendre. Il devenait angoissé. Lorsque l’idée finissait par surgir, c’était le soulagement, l’extase d’un moment.»
Getty ImagesLa première fois que je l’ai rencontré, c’était dans son vaste atelier qui donnait sur la place Saint-Sulpice, au cœur de Paris. J’étais là pour l’interviewer. Il m’intimidait, et ma timidité l’intimidait à son tour. Il me pria de le tutoyer: «Moi, c’est Jean-Jacques.» Je lui parlai du dessin, de ses confrères dessinateurs qu’il aimait tant, qu’il admirait: Chaval, Saul Steinberg et bien sûr son grand ami Bosc, et tant d’autres. Le dessin d’humour? A ses yeux, il tenait une place modeste, presque celle de l’artisanat, bien loin de la peinture, cet art majeur qu’il regardait du coin de l’œil. Pourtant, lui, plus que tout autre dessinateur, était régulièrement exposé dans des galeries, en France et à l’étranger. Et parce qu’il avait dessiné de nombreuses couvertures pour le très chic New Yorker, les Américains l’avaient adopté.

«Cherchez vos noms et votre place. Asseyons-nous et espérons que la mayonnaise prenne»
Sempé - Editions DenoëlUne fois, j’avais parlé de dessinateur «humoristique». Quelle bévue n’avais-je pas dite? Il n’était pas question d’user de cet adjectif, mais du simple qualificatif d’humoriste. «Je suis un dessinateur humoriste», répétait-il, agacé. Il avait raison. Il ne se considérait pas non plus comme un «dessinateur de presse», ne commentant jamais l’actualité du jour, ne s’abaissant pas à faire des caricatures d’hommes politiques, ni à relater des événements vite oubliés. Son dessin à lui est resté au-dessus du temps fugitif; il s’en prend à la société tout entière, agit comme un révélateur, fustige ses travers, son ridicule. Il la décortique, la dépèce; il met à nu, avec une infinie tendresse, sans rire trop fort, juste un sourire, le sourire juste.

Jean-Jacques Sempé a été l’un des artistes les plus sollicités par le prestigieux magazine américain «The New Yorker», avec une centaine de couvertures dessinées de sa main.
The New YorkerUne chose le tourmentait au-delà de tout: trouver le gag, la situation drôle. Il pouvait passer des heures et des jours à attendre qu’une idée vienne. Il devenait angoissé. Mais lorsqu’elle finissait par surgir, c’était le soulagement, l’extase d’un moment. Sa vie, disait-il, était soumise à cette quête sans cesse renouvelée.
A force de déjeuner ou de dîner avec lui et ses amis, j’ai observé certains traits de sa personnalité: un humour, dans la vie, parfois vachard, acerbe, un sens de la répartie digne des héros de Molière – il aimait batailler avec les mots. Grand séducteur, avec ses yeux bleu d’azur, son sourire ravageur, il s’interdisait de seulement évoquer la sexualité de ses semblables. Ses dessins sont toujours d’une grande pudeur, d’une délicatesse constante. Il ne supportait pas la vulgarité; les déballages sexuels et, pire encore, scatologiques. Cela ne l’empêchait pas de déjeuner régulièrement avec ses confrères Reiser, Topor ou Wolinski.
Sempé se regarde, Sempé se lit. Dessin et légendes ne font qu’un. Sachant dessiner à merveille, il aime suggérer, laisser des blancs, aller à l’essentiel, même si l’essentiel se construit dans un décor immense, fourmillant de détails.

La solitude d’un personnage qui a pourtant tout: dessin tiré de «Luxe, calme et volupté» et figurant dans le numéro spécial de Reporters sans frontières «100 dessins pour la liberté de la presse».
Jean-Jacques Sempé / Reporters sans frontières No 61La plupart de ses dessins sont «illustrés» par des légendes, toujours remarquablement écrites, elles aussi. En quelques mots – parfois, cependant, une longue tirade –, il va à l’os. Il connaît par cœur la vanité des discours, leur préciosité, leur pédantisme, mais aussi leur apitoiement. Un dessin, une légende: et tout est dit, comme un coup de poing dans la figure donné avec une infinie douceur. Sempé est parfois cruel, l’air de ne pas y toucher. Il connaît trop la petitesse humaine – cette femme, minuscule dans l’église vide, qui tente de s’adresser au Seigneur. Elle pourrait être transfigurée par le Saint-Esprit, il suffirait de si peu, mais voilà, Sempé nous montre bien la difficulté d’atteindre ce «si peu». Et ce petit homme, chapeau sur la tête, seul, immensément seul devant le soleil couchant; lui aussi, il est «si peu de chose».

«Que vous n’existiez pas, soit. Mais à ce point, c’est indécent», dit le personnage. Dessin tiré de «Garder le cap», Ed. Denoël, 2020.
Inside MediaTout cela n’est pas venu en un jour: ce fut un long chemin. Né en province, du côté de Bordeaux – il a grandi dans un milieu difficile, et modeste –, il est monté à Paris avec la ferme intention de publier ses dessins dans la presse nationale. Devant les rédactions, il a fait la queue avec ses confrères, soumettant ses trouvailles à des rédacteurs en chef impitoyables: «Tiens, je te prends celui-ci, et puis celui-là, le reste, rempaquette-le!» A l’époque, après la guerre, les journaux publiaient des pages entières de dessins d’humour. J’en ai plusieurs fois parlé avec lui. Morez, Aldebert, Barberousse, Tetsu et tant d’autres: il parlait de ses confrères avec un tremblement dans la voix. Ses compagnons de la mouise. Il était de leur race. Gagnant trois francs six sous par dessin.
>> Lire aussi: La BD est née en Suisse romande
A force d’obstination, il a forgé son style, son talent – qui deviendra du génie –, Sempé est devenu Sempé. Bien sûr, Le Petit Nicolas, avec l’amicale complicité de René Goscinny, l’a propulsé au sommet des ventes et de la notoriété. Mais si l’on veut comprendre Sempé, il faut lire et regarder ses albums, qui sont autant d’essais psychologiques, voire sociologiques. Sans jamais blesser quiconque, il a bâti une œuvre unique, qui le hisse au rang des grands moralistes français – La Rochefoucauld, Chamfort, La Bruyère, Vauvenargues, Joubert. On pourra le «lire» et le relire dans cent ans: à nos descendants, il rappellera nos névroses, nos petites lâchetés, nos capitulations devant le progrès intempestif. Il leur dira, mieux que de lourds traités, notre fragilité drolatique. Sempé disparu, il faut se replonger dans ses merveilleux albums – il en publiait un chaque année – afin de mieux saisir le monde qui est le nôtre depuis plus d’un demi-siècle. Jean-Jacques n’est plus là, mais Sempé est éternel.



