Bonjour,
Yann Queffélec: «Avec le Goncourt, le succès a failli me détruire»
Yann Queffélec, l'auteur des «Noces barbares», primé en 1985, analyse les dégâts engendrés par le choc de son triomphe littéraire et la longue convalescence qui s’est ensuivie. Si le Goncourt, décerné le 3 novembre, est une chance, c’est aussi parfois une malédiction. Certains perdants ne s’en relèvent jamais.
Didier Dana

Yann Queffélec a été couronné à 36 ans par le Prix Goncourt 1985 pour son deuxième roman, «Les noces barbares», un chef-d’œuvre d’amour et de mort. L’auteur, d’abord critique littéraire au «Nouvel Obs», est fils d’écrivain, c’est aussi un navigateur avisé. Il a consacré un livre à sa «sœur d’affinités», la navigatrice Florence Arthaud, intitulé «La mer et au-delà» (2020), bientôt porté sur grand écran.
William Dupuy/Divergence- Votre roman «Les noces barbares» a eu du succès avant d’être couronné par le Goncourt en 1985. Qu’attendiez-vous de ce prix?
- Yann Queffélec: Le Prix Goncourt, d’abord, on n’y croit pas. Pas une seconde. Il ne vaut mieux pas, d’ailleurs. C’était très bien d’avoir été sur la liste finale et j’étais passé au livre d’après. Fils d’écrivain (Henri Queffélec, ndlr), je me disais que les prix, ce sont des magouilles. A ce moment-là, j’avais une espèce de vie de pacha du côté de Los Angeles. J’écrivais dans les coulisses des salles de concert, marié à une pianiste (la concertiste Brigitte Engerer, ndlr). Dans la journée, je jouais au tennis avec Jean-Claude Casadesus, grand chef de l’orchestre de Lille. Bref, le Goncourt, ce n’était pas pour moi. Et j’ai été rappelé de manière très autoritaire par mon éditeur. Parce qu’il y avait quand même, autour du prix, des impératifs commerciaux importants.
- Dans quel état d’esprit êtes-vous revenu en France?
- En bougonnant, d’une humeur épouvantable. Jusqu’à la veille de la proclamation, je me disais: «Je vais retourner à L.A. C’est inutile.» Le matin même, j’ai repensé à ma mère, que j’avais perdue à l’âge de 18 ans. J’en avais 36. J’ai eu le besoin d’aller sur sa tombe en traversant Paris à pied. Une fois arrivé, j’ai compris qu’il se passait quelque chose qui était de l’ordre du destin. C’était la première fois que je ressentais ça.
- Quoi donc?
- Que j’avais fui, que j’étais beaucoup plus fragile que je ne voulais le montrer. Que j’avais méconnu le sens du Goncourt, que j’avais essayé de ne pas m’identifier à cette chance qui pouvait être la mienne et qui pouvait aussi ne pas l’être. Et j’ai parlé à ma mère. Si je n’avais pas le Goncourt quelques heures plus tard, qu’est-ce que j’allais devenir? Qu’allais-je faire après? Qui étais-je?
- Qu’avez-vous fait avant la fameuse désignation du lauréat à 13 heures chez Drouant?
- J’ai été invité à déjeuner par Antoine Gallimard, mon éditeur. Il m’a dit: «Ecoute, on sait maintenant que ce n’est pas toi le Goncourt, ça n’a aucune importance. Ton livre a fait un beau parcours (150 000 exemplaires avant le prix, ndlr). Il va continuer à se vendre, ce n’est pas grave, ce sera une autre année. Viens à la maison. On assistera au résultat à la télévision.» Nous avons déjeuné avec lui et sa femme. Il a sorti un excellent bourgogne. Il y avait des côtes de veau à la crème. A un moment, il a reçu un coup de téléphone. Il est revenu à table et son épouse a demandé: «Qui a téléphoné?» Il n’a pas répondu. Sa femme a insisté: «Pourquoi tu ne le dis pas?» Il a fini par lui confier: «C’est mon père. Il voulait juste me dire qui avait obtenu le Prix Goncourt.» Et il a continué à manger.
- Vous attendiez le résultat à la télé…
- Oui, c’était juste avant la proclamation, je me souviens des pubs pour les couches Pampers. La femme d’Antoine ajoute alors: «Tu sais qui a obtenu le Goncourt?» Lui: «Tout à fait.» «Mais alors, qui l’a eu?» demande-t-elle, agacée. Et, du bout de sa fourchette où j’aperçois un morceau de veau et un bout de cèpe, il me désigne sans lever les yeux. «Tu veux dire que c’est Yann?» Il se tourne vers moi et déclare: «Ah oui, j’ai oublié de te dire, mon père est toujours au téléphone et il attend. Il voudrait te féliciter.» Il faisait attendre Claude Gallimard, saint des saints de la littérature à qui les auteurs n’adressaient jamais la parole. J’y vais, n’y comprenant rien, ahuri de l’avoir au bout du fil, et effectivement, il me congratule. Je n’ai pas raccroché que j’ai eu l’impression d’entrer dans un rêve, harponné par Antoine qui m’emmenait par une porte de service, les journalistes et les télés, je ne sais comment, klaxonnaient déjà dans la rue.

Présent au Livre sur les quais, à Morges, en septembre dernier, Yann Queffélec aime dédicacer longuement. «C’est bouleversant. Pour certains, le livre est une planche de salut. Ce radeau de survie est un trait d’union entre l’auteur et le lecteur. Des gens qui ne se connaissent pas et qui brusquement se retrouvent en sympathie, en fraternité.»
William Dupuy/Divergence
Présent au Livre sur les quais, à Morges, en septembre dernier, Yann Queffélec aime dédicacer longuement. «C’est bouleversant. Pour certains, le livre est une planche de salut. Ce radeau de survie est un trait d’union entre l’auteur et le lecteur. Des gens qui ne se connaissent pas et qui brusquement se retrouvent en sympathie, en fraternité.»
William Dupuy/Divergence- Que s’est-il passé en vous?
- A ce moment-là, vous perdez complètement votre identité. Le Goncourt, c’est d’abord ça, une perte d’identité: vous ne serez plus jamais celui que vous étiez avant. Vous n’êtes plus personne. C’est un cataclysme dans la vie d’un écrivain, plus encore avec un livre appelé à très bien marcher. Ça a été le meilleur Goncourt du XXe siècle en termes de chiffre d’affaires. En nombre d’exemplaires, j’ai été battu par Marguerite Duras («L’amant» en 1984, ndlr). Et là, je ne suis pas entré dans la suite de ma vie, mais dans un songe. J’ai écrit le livre suivant, ça ne me posait aucun problème, parce que ça faisait partie du rêve.
- Au fil des semaines et des mois, jeune auteur, vous êtes-vous dit: «Serai-je capable de refaire un aussi bon livre?»
- On se le dit, c’était mon deuxième roman. Mais sur le moment, vous entendez répéter, toute la journée, partout, par les plus jolies femmes de la planète, où que vous alliez, que vous êtes un génie. Le Goncourt était alors un événement non seulement national mais international. A force d’entendre dire que vous êtes un génie, vous finissez par trouver ça tout à fait naturel. Je n’étais pas plus prétentieux pour autant. Mes amis restaient mes amis. De toute façon, la terre entière est votre amie. C’est ça qui est extrêmement dangereux et déstabilisant. Parce que, de la même manière que lorsque vous vous asphyxiez vous ne sentez pas l’odeur du gaz qui vous tue, de la même manière, le succès est en train de vous détruire et vous ne vous en rendez absolument pas compte.
- Cet état de grâce, combien de temps dure-t-il?
- Ça dure un an. Ensuite, vous voyez arriver le Goncourt suivant. Vous vous dites: «Mais qu’est-ce que c’est que cette blague? C’est moi, le Goncourt!» Vous pensez qu’il s’arrête avec vous. Et vous commencez à souffrir. D’abord, parce que le regard du public et des médias change. Vous êtes un tout petit peu moins dans la lumière et les premiers ricanements se font entendre. Les ricanements de l’espèce humaine. Au début, vous étiez dans la gloire et tout le monde voulait être dans la gloire avec vous. On voit ensuite que vous allez vous retrouver un petit peu seul. Et plus vous vous retrouvez seul, plus on vous isole. Il y a une grande période de solitude et c’est à ce moment-là que vous commencez à vous reconstruire. Vous devenez convalescent de cet énorme succès et ça peut durer un paquet d’années.
- En 2018, pourquoi avez-vous écrit «Naissance d’un Goncourt»?
- Ce livre et les deux qui ont suivi, dont un sur Florence Arthaud, fille d’éditeur, passionnée des mots et de la mer, ont mis fin à mes années Goncourt. J’ai terminé ma convalescence.
- Trente-trois ans, la convalescence a été longue.
- Très longue. Mais je ne le réalisais pas. Maintenant, oui. Ma relation avec mon écriture, avec mon stylo et ma solitude n’est plus celle qu’elle a été pendant près de vingt-cinq ans, quand je me laissais porter par la vague du Goncourt, par le sentiment que tout allait bien. Ce n’était pas vrai. Tout n’allait pas bien. J’étais quelqu’un d’extraordinairement morcelé, abîmé par le succès et les mauvais tours qu’il vous joue. Vous devenez méconnaissable pour votre entourage. J’ai eu une vie privée accidentée. Récemment, un documentaire sur Jean-Luc Delarue m’a bouleversé. Le succès et le compliment permanent, sur ce qu’on est et sur ce qu’on fait, sont un poison dangereux. Lui s’est drogué. Moi jamais, mais il y a d’autres types de perdition. Et je ne suis pas perdu. Avec «Naissance d’un Goncourt», j’ai compris que j’avais renoué avec la littérature au sens le plus noble, le plus simple. Mon dernier roman, «D’où vient l’amour» (2022), est, après «Les noces barbares», le livre le plus vrai et le plus achevé que je pouvais écrire.
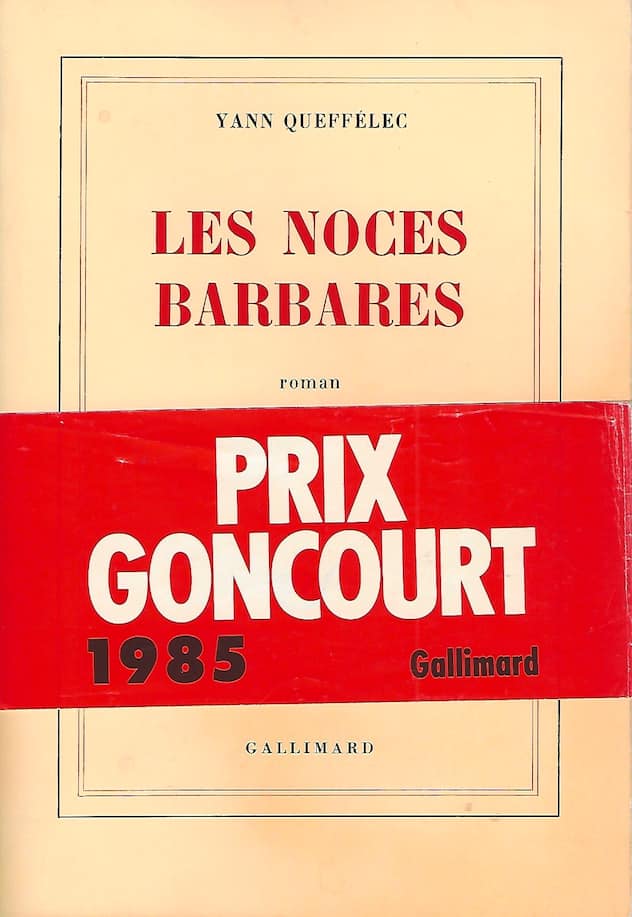
Attribué pour la première fois en 1903, le prix avait pour but de permettre au lauréat de se défaire des soucis financiers. Le bandeau Goncourt assure, dit-on, entre 350 000 et 400 000 exemplaires vendus, mais pas toujours. Queffélec, plus gros chiffre d’affaires, en a écoulé plus de 2 millions. Marguerite Duras aurait fait mieux, en unités vendues, avec «L’amant» (1984). Ils pourraient être battus par «L’anomalie», d’Hervé Le Tellier (2020), déjà parti à 1 million d’unités avant même d’avoir connu une édition en petit format.
Ed. Galimard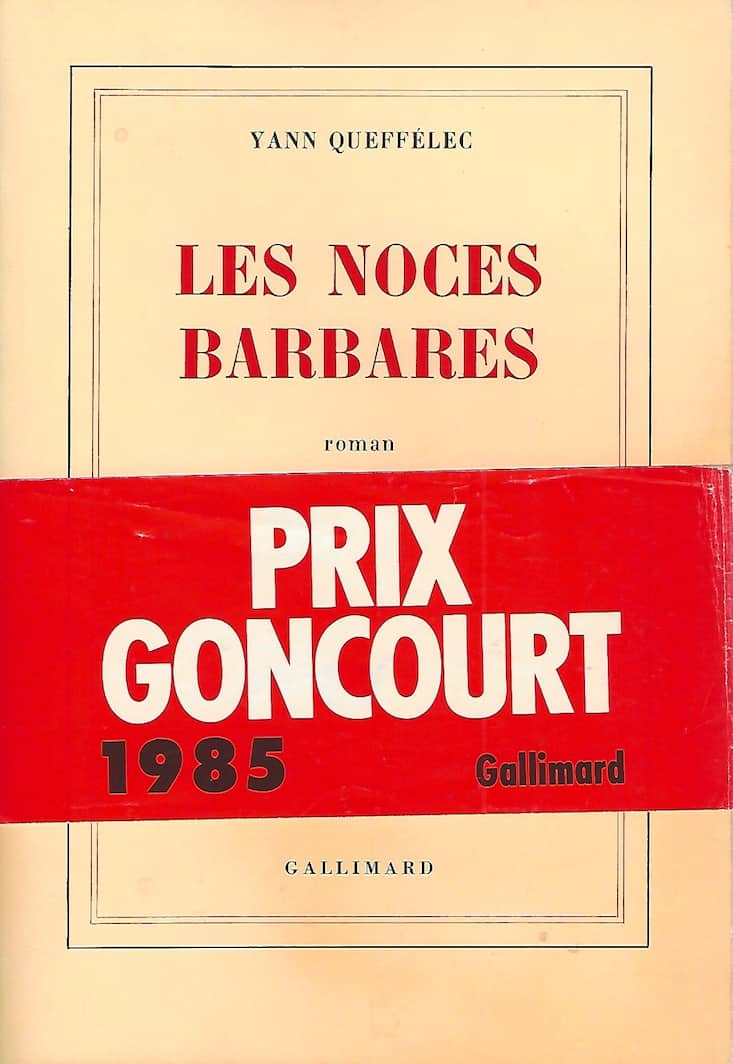
Attribué pour la première fois en 1903, le prix avait pour but de permettre au lauréat de se défaire des soucis financiers. Le bandeau Goncourt assure, dit-on, entre 350 000 et 400 000 exemplaires vendus, mais pas toujours. Queffélec, plus gros chiffre d’affaires, en a écoulé plus de 2 millions. Marguerite Duras aurait fait mieux, en unités vendues, avec «L’amant» (1984). Ils pourraient être battus par «L’anomalie», d’Hervé Le Tellier (2020), déjà parti à 1 million d’unités avant même d’avoir connu une édition en petit format.
Ed. Galimard- «Les noces barbares», c’est le récit brillant, douloureux et bouleversant de Ludovic, né d’un viol, rejeté par sa mère. Pourquoi avoir imaginé cette histoire?
- Longtemps, j’ai répondu: «Comme Julien Green, mes intentions étaient obscures.» En réalité, pas du tout. J’ai perdu ma mère très jeune. Cette femme extraordinaire croyait en moi, ce que ne faisait pas mon père. Je pense que je me suis un peu livré à de la psychanalyse sur ma personne. La frustration de ne plus avoir ma mère n’a cessé de se développer de manière souterraine chez moi. «Les noces barbares» traduit cette frustration d’un enfant qui réclame à sa mère un amour qu’elle est incapable de lui donner, de la même manière que j’ai réclamé à la mienne un amour qu’elle ne pouvait plus me donner. Je me suis dit: «Qu’est-ce qui peut faire qu’une mère aime son enfant et le rejette en même temps?» Et j’ai pensé au viol d’une femme vierge par l’homme qu’elle aime plus que tout et dont elle attend le plus grand des amours. Le livre commence par cette agression d’une adolescente, par son amoureux, un soldat américain, et ses deux copains.
- En 1985, le Goncourt, que se partageaient Gallimard, Grasset et le Seuil, tenait une place importante dans les médias et surtout à la télévision.
- Il y avait Bernard Pivot, Jacques Chancel, les JT, le «13 heures» d’Yves Mourousi sur TF1. Les jurés venaient parler des livres. Avec le Goncourt, tout un jeu social très dangereux pour l’écrivain se met en place. On avait juré à Michel Braudeau qu’il l’aurait (pour «Naissance d’une passion»; il a perdu contre Queffélec au sixième tour, par quatre voix contre six, ndlr). Il ne s’en est jamais remis. Il est devenu alcoolique. Tout le temps qui précède, les écrivains entendent leur éditeur leur dire: «C’est toi qui vas l’avoir.» Et l’écrivain ne l’a pas. Gallimard l’avait promis à Hector Bianciotti la même année. Or, c’est moi qu’ils soutenaient. Il a été manipulé. Certains ont reçu le Goncourt, leur livre n’a pas marché et ils ont été oubliés.
- Ce fut le cas pour Michel Host l’année suivante avec 70 000 exemplaires, là où le Goncourt en fait miroiter 400 000. Combien en avez-vous vendu
- Deux millions, et il se vend encore. Peu avant le prix, les Editions Gallimard m’avaient mensualisé. Franchement, pour qu’ils mensualisent un auteur, il fallait se lever tôt. Une espèce d’impulsion commerciale incroyable portait ce roman – adapté au cinéma en 1987.
- Etiez-vous conscient de sa valeur littéraire en l’écrivant?
- J’avais pleuré en rédigeant les dernières pages. Et je me disais: «Si j’ai pleuré, c’est que d’autres peuvent pleurer aussi.» Il y avait quelque chose qui me plaisait. Mais la comédie littéraire, je la connaissais par cœur. Je savais que c’était extrêmement dangereux de s’identifier à des succès potentiels. Mon père avait cru qu’il allait entrer à l’Académie française. Il avait écouté tous ceux qui lui disaient: «On va voter pour vous.» Et puis rien. J’avais vu mon père, un monument, s’effondrer. Il n’en revenait pas.
- D’où votre méfiance initiale?
- Exactement. Je dois énormément aux «Noces barbares». C’est une magnifique aventure. J’ai gagné un fric fou et je n’ai cessé de le flamber. J’ai eu honte de l’argent que je gagnais, comme si j’avais usurpé le prix à mon père, romancier avant moi. Je ne portais plus les chèques à la banque. J’en avais ras-le-bol de cet argent, j’en donnais à tout le monde. Mon père, lui, n’a pas du tout apprécié que j’obtienne le Goncourt. Il ne l’a pas eu (en 1945, pour «Un recteur de l’île de Sein», ndlr) et n’a pas été admis à l’Académie française. Ce livre, je le lui ai apporté, comme je l’aurais apporté à ma mère. Je pensais qu’il n’y avait pas un plus beau cadeau qu’un enfant puisse faire à ses parents et il m’a repoussé avec violence. J’adorais mon père, qui ne m’aimait pas.
- Au danger des honneurs et de l’argent s’ajoutait la rancœur. La jalousie, aussi?
- Ah ça, la jalousie… Vous découvrez que tous ces gens qui vous ont encensé, qui vous ont aimé, en apparence, n’ont cessé de vous jalouser.
- Vous dites que vous vous êtes retrouvé avec «Naissance d’un Goncourt». Mais que s’est-il passé pour l’auteur Yann Queffélec entre 1985 et ce livre sorti en 2018?
- J’ai fait le job. J’ai nourri ma famille. J’ai écrit des livres (trente-six, ndlr) qui valent ce qu’ils valent, le «Dictionnaire amoureux de la Bretagne», celui «de la mer», ce sont de bons livres. «L’homme de ma vie» (2015), sur mon père, justement, il paraît que c’est un très beau livre d’un fils sur son père.
- Qu’écrivez-vous en ce moment?
- Je n’en parle jamais avant. J’ai été lessivé par l’écriture de mon dernier roman, c’est un très bon signe. Je récupère. Je n’ai pas renoué avec le roman d’après. Ce qui ne saurait tarder, j’ai très envie de m’y remettre.
- Ecrire, c’est un besoin?
- Extraordinaire. Je me lève très tôt le matin. Sur ma page, l’univers m’appartient. Je suis le roi. C’est d’une mégalomanie totale. Mais un écrivain est totalement mégalomaniaque, sinon il ne tournerait pas le dos au monde, ne se pencherait pas sur une page en considérant qu’un public l’attendra le jour où il sera arrivé au bout. C’est d’un culot formidable. Mais physiquement, quand vous trouvez une phrase qui sonne vrai, qui sonne juste, quand le personnage commence vraiment à vibrer comme s’il faisait partie du monde, avec sa voix, son histoire, ses contradictions, ses péchés, ses vertus, vous êtes comme un démiurge. Moi, j’attends ça avec impatience. C’est la grande aventure de l’émotion. Et vous n’avez qu’une envie, c’est de la transmettre au public.