Bonjour,
Monica Sabolo: «On peut pardonner et ne pas pardonner en même temps»
Elle est née à Milan, a grandi à Genève, Monica Sabolo a beaucoup écrit sur la Suisse et vit à Paris. «La vie clandestine», son septième livre, qui revient notamment sur les traces de son passé dans la Cité de Calvin, s’est aussitôt imposé dans cette nouvelle rentrée littéraire. Rencontre.

Julie Rambal

Au fil des livres, Monica Sabolo, 51 ans, déploie son style à part, où la poésie du langage sonde la noirceur du monde.
Manuel BraunTout le monde s’accorde à dire que le nouveau roman de Monica Sabolo est magistral et parie déjà sur les prix qu’il pourrait remporter, alors que, dès sa parution, à la mi-août, il était sélectionné pour nombre d’entre eux. Au fil des livres, de «Crans-Montana» à «Summer», l’écrivaine déploie son style à part, où la poésie du langage sonde la noirceur du monde. Avec «La vie clandestine» (Gallimard), Monica Sabolo ausculte de nouveau la violence, en intriquant cette fois deux récits qui finissent par se répondre. Deux enquêtes: l’une sur le collectif Action directe, groupe armé d’extrême gauche français, qui assassina l’industriel Georges Besse, au milieu des années 1980, entre les braquages et les planques; l’autre sur son propre passé, entre l’Italie, la Suisse et les secrets de famille. En remontant le fil des violences et des traumas, Monica Sabolo finit par trouver un lieu qui ressemble un peu à la réponse que donnait Donald Winnicott, pédiatre et psychanalyste, à «la crainte de l’effondrement», cette angoisse qui n’a jamais été si puissante qu’aujourd’hui: «Nulle vérité n’est absolue ni finale. Ce qui compte, c’est l’action de penser, de sentir, et la liberté de réfléchir.» Un récit d’une humanité bouleversante, qui hisse l’Italo-Genevoise parmi les grands noms de la littérature. Entretien.
- Dans ce livre, vous rendez sa fragilité au monde. Comment l’aviez-vous envisagé?
- Monica Sabolo: Je ne le savais pas. Au départ, j’avais une question assez simple. Je m’interrogeais sur ces deux filles, Nathalie Ménigon, 29 ans, et Joëlle Aubron, 27 ans, qui attendent un grand patron sur un banc et qui l’abattent de sang-froid. Et je me disais: comment en arrive-t-on là? Elles étaient jeunes, ça me paraissait insensé, je voulais comprendre. Je ne me rendais pas compte que ça répondait à des interrogations très personnelles. Et il y avait également le fait que personne ou presque parmi les membres d’Action directe n’avait semblé jamais émettre le moindre regret. Personne ne semblait douter et, comme moi, je doute tout le temps, ça me heurtait beaucoup. Après, je me suis fait rattraper par l’humanité, et l’ambivalence. Le fait qu’il y a des belles choses, et de la violence, et que tout cela peut cohabiter dans un même être. J’ai découvert que plus on s’approche, plus on va vers la nuance. Et vers l’humain.
- On croise beaucoup de jeunes filles blessées dans vos romans. Il y a une colère feutrée. Est-ce que votre intérêt pour les femmes d’Action directe, qui ont usé de la violence pour ce qu’elles pensaient juste, a un lien?
- Elles ont laissé agir leur colère, finalement, jusqu’au pire. C’est cela qui travaillait. C’est-à-dire que c’est une lutte pour le bien de l’humanité selon elles, et selon tous ces combattants révolutionnaires, et, en même temps, il y a un glissement qui les emmène vers des crimes irréparables et une violence qui, pour moi, est injustifiable. Mais je n’ai pas senti cette colère au départ. C’est en plongeant dans les documents d’époque, en essayant de mieux comprendre la violence sociale qui régnait, que j’ai pu toucher du doigt cette colère qui finalement faisait écho à la mienne.
- Mais plus vous cherchez la vérité, plus elle se dérobe?
- Est-ce une extrême jeunesse, le côté enfantin de la tendresse, de l’amitié, de la solidarité et de l’humour? Puisqu’il y en avait aussi. Ça n’enlève rien, ça ne justifie rien, mais c’était là également. Les individus disparaissent dans la lutte collective et pourtant, quand on s’approche, on voit qu’il y en a certains qui sont incapables de regretter, d’autres qui regrettent, d’autres qui étaient contre les exécutions, ce sont des hommes, chacun a un point de vue, ils ne sont pas tous les mêmes. Mais par solidarité et fidélité à la lutte, le point de vue personnel n’est pas audible, il faut avoir une sorte de discours collectif. Je trouve cela effrayant.

«Comment trouve-t-on la paix? En acceptant peut-être qu’il n’y a pas de réponse tranchée.», Monica Sabolo.
Manuel Braun
«Comment trouve-t-on la paix? En acceptant peut-être qu’il n’y a pas de réponse tranchée.», Monica Sabolo.
Manuel Braun- Une famille aussi, c’est du collectif.
- Oui, c’est vrai. On est liés. Chaque parole de l’un va potentiellement blesser ou mettre en danger ou faire sauter l’équilibre familial, qui est parfois assez fragile.
- Cette enquête est-elle une quête de repentir?
- J’étais extrêmement heurtée par le fait que quarante ans après, il n’y avait pas de discours nuancé, ou qui reconnaissait la souffrance commise. J’ai finalement rencontré quelqu’un qui la reconnaissait, Régis Schleicher, et c’est à ce moment-là que j’ai compris que c’était ce que je cherchais. J’ai mis longtemps à comprendre ce que je faisais, mais c’est un livre sur le pardon. A-t-on le courage de regarder en face les actes que l’on a commis, étant donné que mon père n’a jamais vraiment exprimé ce genre de choses et n’a jamais pu regarder en face ce qu’il avait fait?
- Et Nathalie Ménigon?
- Elle ne le dit pas, c’est son corps qui exprime des choses, ce qu’elle ne se formule peut-être même pas à elle-même. Après, c’est aussi ce que moi, je vois, le fait qu’elle n’arrive plus à respirer, le trouble dans lequel je la vois plonger, qui m’inspirent cette interprétation, mais je ne suis pas du tout persuadée qu’elle dirait cela.
- Entremêler dans ce récit la violence de votre histoire, c’était mettre fin aux secrets une bonne fois pour toutes?
- Dans mes précédents livres, j’habillais cela d’un maximum de précautions, d’images poétiques comme on plaque un oreiller pour assourdir le bruit de la violence et là, je dis les choses. De livre en livre, on chemine, on avance, jusqu’au point où on ne peut pas aller plus loin. Je pensais que j’en avais terminé, que je n’écrirais pas sur ma famille, et ça s’est imposé, c’est le livre où je parle le plus de ma famille.
- Annie Ernaux, Edouard Louis… Notre époque aime les auteurs de récits de l’intime, de la vérité qui ne passe pas par le travestissement de la fiction. Pourquoi, selon vous?
- En tout cas, c’est ce que j’aime lire. Je suis très intéressée par la non-fiction, et je trouve qu’il y a une vraie modernité dans beaucoup de textes. Nous avons besoin de regards sur le réel, de quelque chose de tangible, parce que tout semble se craqueler et fuir. Nous sommes dans un moment de grande transition, où tout bouge très vite, la nécessité du réel est plus grande dans les périodes de troubles.
- Même dans la tragédie, vous trouvez souvent une dimension burlesque. C’est important?
- La fantaisie, le regard décalé, c’est comme ça que je traverse l’existence. Cela me sauve parce qu’à partir du moment où on commence à rire d’une situation, et voir la folie dans laquelle on est plongé, on a fait un petit pas de côté, on est déjà un peu moins pris dans les griffes du destin. Et puis j’adore les aventuriers du quotidien, quand les petites catastrophes de tous les jours deviennent des odyssées.
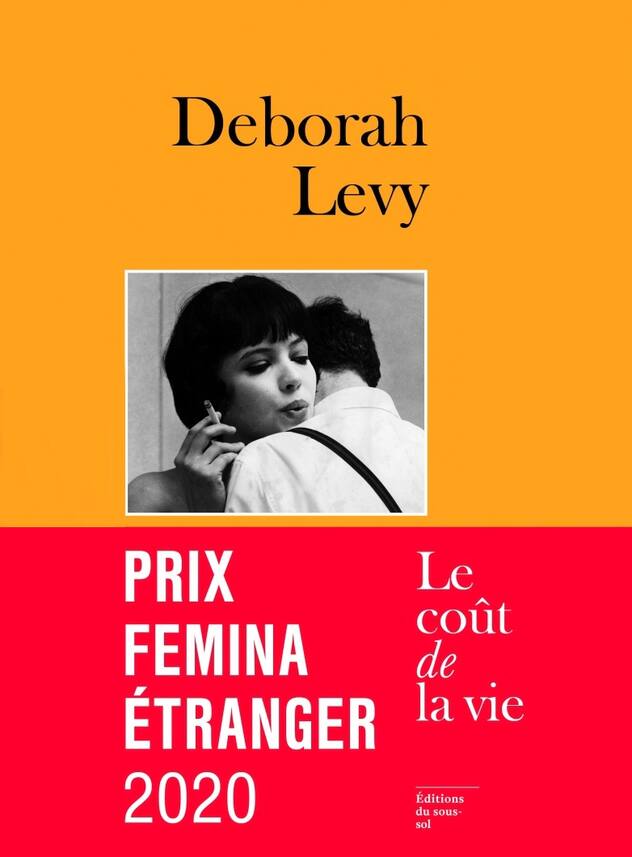
S'il n'y avait qu'un seul livre...: «Le coût de la vie», de Deborah Levy: «Son épopée du quotidien, qui s’interroge sur la façon d’être une femme libre, est lumineuse d’intelligence, de fantaisie et d’allant, même dans la catastrophe.»
Editions du sous-sol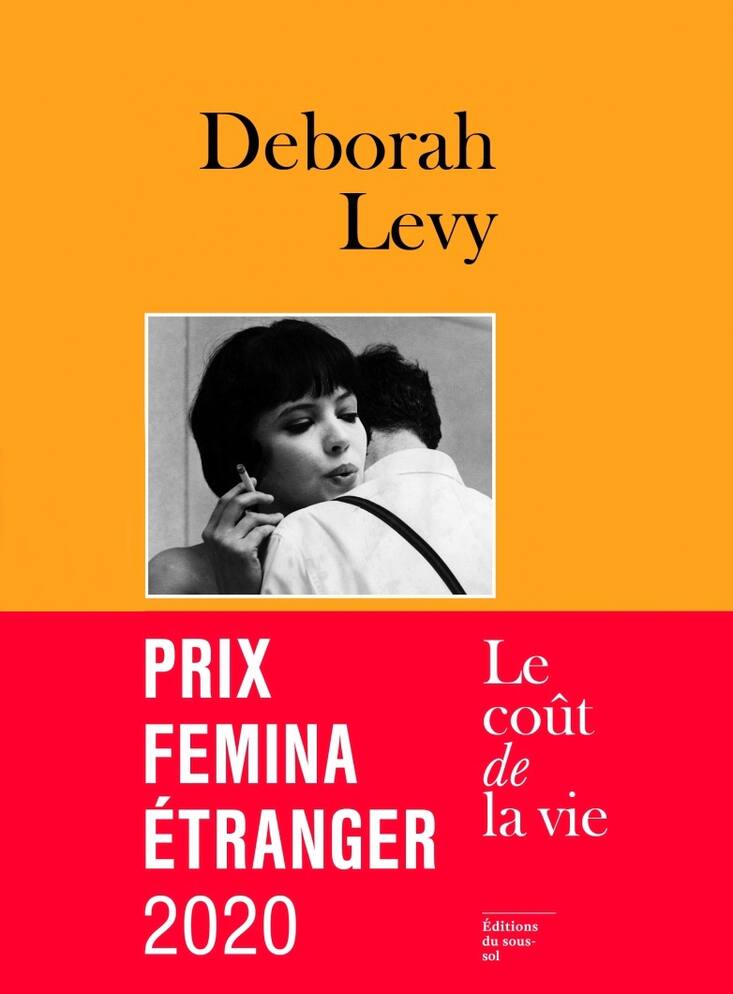
S'il n'y avait qu'un seul livre...: «Le coût de la vie», de Deborah Levy: «Son épopée du quotidien, qui s’interroge sur la façon d’être une femme libre, est lumineuse d’intelligence, de fantaisie et d’allant, même dans la catastrophe.»
Editions du sous-sol- «La vie clandestine» raconte aussi la fin d’un monde, celui des rêves d’égalité, remplacés par l’idéologie de la réussite des années 1980, son fric, sa flambe, qui étaient l’univers de votre adolescence.
- A bien des égards, quelque chose s’est joué dans ces années-là, de l’ordre de la dilution du collectif. Il y a effectivement les derniers sursauts de l’espoir, l’utopie de la révolution, et d’un monde plus juste, et, d’un autre côté, le mythe de l’individu en autoentrepreneur, avec les Bernard Tapie et Paul-Loup Sulitzer. Ce sont les années de la naissance de notre monde actuel, de l’ultralibéralisme et de l’individualisme. En me replongeant dans les documents d’époque, j’ai été frappée qu’aujourd’hui l’expression «lutte des classes» n’existe pas. Elle est datée, comme si elle avait disparu au profit d’autres luttes. Oui, il y en a d’autres, mais celle-ci est centrale. L’augmentation des disparités, l’exploitation des ressources naturelles, la mise en fragilité du monde sont le foyer brûlant de la lutte des classes, qui, à mon avis, va ressurgir de façon très forte. Pourtant, quand quelque chose n’est pas nommé, c’est comme s’il n’existait pas. On bute toujours sur le même écueil, celui d’une souffrance qui n’est pas entendue, ni reconnue, et elle monte, avec le besoin d’être appréhendée réellement.
- Derrière la course au fric, il y a toujours de la prédation?
- A partir du moment où le but est d’en accumuler le plus possible, quel qu’en soit le prix, il y a forcément quelque chose de l’ordre de la domination. La réussite personnelle, le fait de s’enrichir, d’avoir une belle vie, de s’élever socialement, n’est pas mal; le problème est quand l’autre commence à ne plus exister, que l’avidité se nourrit d’elle-même. Ce livre est l’histoire d’un glissement, qui est des deux bords, celui-ci et celui de la lutte pour une société plus juste qui va jusqu’à tuer l’homme au nom d’une idée. Dans les deux extrêmes, il y a quelque chose de glacé.
- Vous évoquez les activités aussi mystérieuses qu’enrichissantes de votre père dans ces années-là, à Genève. La Suisse est-elle l’endroit rêvé du secret?
- J’en ai une grande nostalgie. C’est-à-dire que je trouve le pays extrêmement beau, avec des gens plutôt doux et chaleureux. Quand je suis arrivée à Paris, ça m’a paru un monde sauvage, hyper-attirant parce que très vivant, mais cette douceur me manque. Et à la fois, un endroit dont l’ombre semble absente est forcément suspect. Il y a une sorte de calme apparent qui est louche. Donc oui, je pense que c’est le monde du secret également, un endroit très romanesque, comme le lac Léman, où l’on ne sait pas trop ce qu’il y a dessous, qui nourrit mon imaginaire d’auteure.
- Vous parlez beaucoup de la mémoire des lieux. Quel souvenir gardez-vous de Genève?
- Une émotion ambivalente de nostalgie et d’effroi.
- En suivant la piste de la lutte armée, vous ne saviez pas que vous remonteriez aux racines de vos traumas. Et pourtant, ces histoires finissent par se faire écho merveilleusement.
- Je me demande si notre regard et nos émotions sur les événements historiques n’ont pas toujours quelque chose à voir avec ce qui nous regarde intimement. Parfois, on ne le sait même pas, mais ils rebondissent sur nos chagrins, nos colères, et peut-être des choses transmises de génération en génération. Le témoin impartial n’existe pas. Interroger notre capacité à retranscrire les événements, c’est aussi s’interroger sur la mémoire qui est défaillante.
- Comment trouve-t-on la paix?
- En acceptant peut-être qu’il n’y a pas de réponse tranchée, qu’on peut pardonner et ne pas pardonner en même temps.
- C’est à l’opposé de la colère…
- La colère est forcément une étape, encore faut-il avoir les moyens de pouvoir passer à autre chose. Et c’est vrai que j’ai cette chance, l’écriture. Ce que j’ai vécu a été très important, mais je crois que la clé est dans l’écriture.