Bonjour,
Joël Dicker: «Je suis Suisse parce que ma famille a fui le nazisme»
Avec son nouveau roman «L’énigme de la chambre 622» dont la nouvelle date de sortie est fixée au 19 mai, Joël Dicker campe, pour la première fois, son intrigue en Suisse. Nous avons rencontré l’auteur genevois de 35 ans dans la station valaisanne alors que la crise sanitaire arrivait, afin d’évoquer sa famille persécutée pendant la guerre, la paternité et une société qui part à la dérive.
Dana Didier

- Pourquoi avoir choisi Verbier comme théâtre du crime de votre nouveau roman, «L’énigme de la chambre 622»?
- Joël Dicker: Plutôt pourquoi Verbier avant même d’avoir songé au crime? Parce que mon éditeur, Bernard de Fallois, l’homme à qui je dois tout, adorait cette station. Lorsqu’il venait à Lausanne rendre visite à Georges Simenon, il y montait quelques jours. Il m’avait dit: «On ira à Buenos Aires – sa mère était Argentine – et à Verbier ensemble.» Nous n’avons fait ni l’un ni l’autre. Il a disparu le 2 janvier 2018, à 91 ans. Nous nous sommes connus six ans. Pour moi, c’était une façon de faire ce voyage que nous n’avions pas fait ensemble.
- Le Palace n’existe pas à Verbier. Quel est son modèle?
- C’est le Schweizerhof à Flims dans les Grisons. Nous y allions avec ma famille. C’est un souvenir d’enfant. Pour moi, ce sont les plus forts. Je travaille et j’écris en me mettant dans la position d’un enfant avec des yeux admiratifs et ébahis.
- «La disparition de Stephanie Mailer» devait se dérouler à Genève. Vous n’y étiez pas parvenu. Pourquoi avoir réussi cette fois?
- Le métier rentre lentement mais sûrement. Un peintre fait les Beaux-Arts, un pianiste le Conservatoire, mais il n’y a pas de formation d’écrivain. Je continue à apprendre, je suis toujours en apprentissage.
- Joël, votre double romanesque, enquête dans le livre. Il est pris du besoin irrépressible d’écrire. Vous aussi?
- C’est une envie, une urgence, une obsession, un jeu et un plaisir. Je me lève à 4 heures du matin avec l’excitation de me dire: «Qu’est-ce qui va se passer aujourd’hui?» Je suis incapable d’apprécier si c’est bon ou pas, ce qui m’importe, c’est le bonheur que j’éprouve à écrire. Le moment où les pièces du puzzle se mettent en place. Il faut les construire et c’est très stimulant.
- Une fois l’ouvrage achevé, que ressentez-vous?
- Je me dis que ça sera le dernier. L’idée de me remettre au travail, de devoir repartir de zéro, recommencer, tient presque du miracle. J’ai mis deux ans et demi à l’écrire. Le public va le lire en deux jours. Prenez votre temps! (Rire.)


- Malgré votre succès mondial, rien n’est acquis?
- Le recommencement d’un roman est un tel épuisement que j’ai beaucoup de peine à me dire: «C’est dans la poche. Je suis écrivain et j’aurai de quoi faire un livre tous les trois ans.» Le succès m’offre une forme de sécurité, c’est génial mais fragile. Cela peut s’arrêter. Mon livre sort le 17 mars en Suisse*. Il y a une épidémie de coronavirus, les ouvrages pourraient ne pas être livrés (Joël Dicker a depuis décidé de reporter la parution du livre à une date ultérieure, ndlr). L’année 2019 n’a pas été bonne pour l’édition en France. Il y a eu les «gilets jaunes», les grèves de décembre, les gens ont moins consommé. Au-delà du succès, du respect de mes lecteurs, je me projette beaucoup dans la réalité, dans le quotidien, dans la simplicité d’une joie de vivre qui ne dépend pas de ce succès extérieur.
- Les mots «amour» et «vie» reviennent à la fin de vos romans. Pourquoi?
- C’est l’inconscient, sans doute. Une de mes préoccupations est la limite de la vie. La vie unique, la mortalité. Cette limite est difficile pour un écrivain parce que l’on vit précisément du fait de créer des destins qui n’existent pas. Et lorsqu’un lecteur vous interpelle en disant «J’en ai oublié que j’étais à l’hôpital en vous lisant», c’est encore plus fort. La littérature, c’est la vie. Mais ce n’est pas la vie réelle. Finir d’écrire un livre ou sa lecture est une chute. On passe de l’immortalité que le roman permet à la mortalité de sa condition. On se retrouve de nouveau face à soi-même. Face à sa propre fin.
- Combien y a-t-il eu de versions de ce pavé de 570 pages à l’architecture complexe?
- Il y en a eu 65. Je travaille par version. Si je démarre à la troisième personne et que m’aperçois, après 100 pages, qu’il faut écrire à la première, je reprends tout à zéro. Je n’ai ni plan, ni filet, ni fil conducteur, ni ligne directrice, ni post-it. Ce n’est pas une prouesse: j’en suis incapable.
- Quelle a été l’étincelle de départ?
- Le parc Bertrand à Champel (GE). Un lieu de mon enfance. Mes grands-parents habitaient à côté, avenue Alfred-Bertrand (où réside – au 13, dans le livre – son double romancé, ndlr). A partir de là, je me dis: «Qu’est-ce qu’on met dans ce parc?» Il n’y a encore ni personnages, ni intrigue, ni banquiers…
- Le Dicker devenu best-seller, tiré à 4 et quelques millions d’exemplaires, adapté à l’écran, a bien failli ne pas être publié. Pourquoi?
- «Les derniers jours de nos pères» – tout comme les cinq romans précédents – ont été refusés par les éditeurs aussi bien en France qu’en Suisse. Seul Vladimir Dimitrijevic des Editions L’Age d’Homme voulait le sortir. Quelques mois plus tôt, il s’est tué en voiture. C’était donc un roman destiné à ne pas exister. De Fallois était ma dernière chance. Il m’a reçu une heure et demie pour me dire son désintérêt total et à quel point il ne croyait pas en moi.
- Cela vous a affecté?
- Une déprime épouvantable! Je déambulais à Saint-Germain-des-Prés au bord de la Seine en pensant: «C’est foutu, je ne serai jamais publié.» Je ne savais absolument pas ce que j’allais faire de ma vie. Mes pas m’ont mené vers la librairie Gibert Joseph, boulevard Saint-Michel. Au rayon des livres historiques, je trouve des ouvrages sur le Special Operations Executive (SOE) chargé de mener des actions de sabotage et de renseignement à l’intérieur des lignes ennemies pendant la guerre. J’envoie une note bibliographique à Bernard de Fallois afin de lever son scepticisme. C’était le sujet de mon livre. Un mois et demi après, il acceptait de le faire paraître.
- Il découvre ensuite le manuscrit d’«Harry Quebert». C’est le coup de foudre miraculeux. Vous avez 27 ans et il a flairé le succès.


- On avait vendu trois ou quatre exemplaires du précédent. On se retrouve au mois de juin 2012 pour en parler et je le découvre transformé, rajeuni. Ce qui me séduit alors, c’est l’enthousiasme de vie que je retrouve à travers lui. Avant de faire mon nom et ma carrière, il m’a surtout insufflé, à ce moment-là, une capacité à rêver et une envie de vie forte.
- En quoi aviez-vous modifié votre écriture?
- Mes romans précédents étaient des autofictions destinées à plaire aux éditeurs. Je me suis dit: «C’est ma dernière chance, je vais faire un livre de lecteur, pour moi.» J’avais envie de raconter la côte Est des Etats-Unis. C’est une bascule importante car, pour la première fois, j’arrivais à faire appel à des sentiments intérieurs, existentiels: l’émerveillement, la peur, l’appréhension. Bernard de Fallois m’a dit: «Il faut le faire paraître immédiatement. C’est le livre qui décide de son moment de parution.» Et nous nous sommes lancés.
- On vous sent orphelin de cet homme que vous racontez dans le roman en marge de l’intrigue.
- Bernard a été non pas un père, mais un maître. J’ai été son disciple. Il m’a appris à me poser les bonnes questions, m’a outillé pour la vie professionnelle. Il m’arrive de me demander: «Qu’est-ce qu’il aurait fait dans cette situation?»
- Vous appartenez désormais à l’histoire de ses grands auteurs.
- Un jour, je lui dis: «J’ai presque fini, j’aimerais vous lire mon bouquin à haute voix.» Il répond: «Quelle horreur! Marguerite Yourcenar me l’imposait. C’était d’un ennui affreux.» Moi, jeune écrivain, petit disciple, cela me remettait modestement à ma place aux côtés de celui qui avait édité Marcel Pagnol et avait, entre autres, découvert des inédits de Proust qui viennent d’être publiés.
- Vos souvenirs d’enfance sont votre moteur?
- L’enfance, c’est vivre sans limites: sans codes et avec d’infinies possibilités. Dans un parc, c’est imaginer que l’herbe est de l’eau et qu’en tombant dans l’herbe, un enfant tombe dans l’eau, tout en étant conscient que ce n’est pas la réalité. L’enfant est capable – et c’est extraordinaire, nous devrions cultiver ça une fois adultes – de le vivre vraiment. Cette faculté-là réapparaît par la lecture. C’est le seul moment où les choses «existent» alors qu’elles sont pure fiction.
- Il y a un style Dicker qui consiste à balader le lecteur?
- Non, je proteste! On joue ensemble. Je n’aime pas manipuler. Ce livre ne peut exister sans lecteur. Celui-ci participe avec moi à l’expérience. J’ai besoin de lui. Je lui fournis des éléments à partir desquels il travaille, imagine les personnages, les lieux. Le livre existe parce que le lecteur le construit. C’est son roman.
- Vous imposez vos personnages en les affublant de nos étranges. Macaire Ebezner, Lev Levovitch ou Signor Tarnogol. D’où sortent-ils?
- Le prénom et le nom sont importants dans la construction du personnage. Je vais commencer par Monsieur, puis Sir, ensuite Señor et enfin Signor.
- Et Macaire, l’héritier de la banque Ebezner?
- C’est le prénom d’un personnage du plus beau roman de Dostoïevski, «Les pauvres gens». Je vous livre un secret: les personnages changent de prénom au fur et à mesure de mes versions. Celui-ci s’appelait Max, mais ça ne marchait pas. La consonance «Ma» que j’aimais est devenue Macaire. La rythmique est importante.
- Le changement de tempo est très présent. Comme batteur, vous modulez aussi le rythme de l’intrigue jusqu’à son emballement.
- Je suis un musicien raté. J’ai choisi les lettres parce que je n’ai pas réussi dans la musique. Mon rêve d’enfant était d’être musicien et il m’habite encore. J’ai fait autre chose, mais c’est toujours dans un coin de ma tête.
- Ce livre cache de nombreuses références littéraires. L’une d’elles est «Belle du Seigneur». Cohen décrivait «des mouettes à l’œil antisémite». Vous utilisez le terme «enjuivé». Votre famille a souffert de persécutions pendant la guerre...
- Si je suis Suisse, c’est parce que mes grands-parents ont échappé au nazisme. Ma grand-mère a dû fuir l’Est quand les lois fascistes lui interdisaient d’aller à l’école. Le Bout-du-Monde à Genève (devenu le stade du même nom, ndlr) était un camp de réfugiés. Ma famille y a été internée en arrivant en décembre 1942 alors qu’elle fuyait les nazis. Mon arrière-grand-père paternel, Jacques Dicker, avocat et homme politique genevois, a été de toutes les couvertures du Pilori, le magazine d’extrême droite d’Oltramare. Il était placardé comme «le Juif Dicker».
- Cela résonne toujours en vous?
- Ce qui me parle, c’est que l’on voit aujourd’hui des supporters dans les stades de foot jetant des bananes aux joueurs noirs en les traitant de singes. On en est encore là et on ne fait rien. C’est incroyable. J’ai cette inquiétude de me dire: «Où va-t-on?» Malgré tout ce que l’on a vécu, malgré l’histoire, on est toujours dans une société qui dysfonctionne. C’est insupportable!
- Votre souhaitez que la littérature fédère. Les réseaux sociaux, eux, divisent. On se déchire autour de tout et n’importe quoi.
- Il faut arriver à parler du sens de la responsabilité de chacun. La sienne et celle de l’autre. La lecture en fait partie, c’est un enrichissement personnel. La littérature, par sa faute, a raté le virage là où les séries télé ont réussi par rapport au cinéma. Elle est restée un exercice poussiéreux pour les élites. Les gens ont de moins en moins le réflexe de lire dans le bus, à la pause déjeuner. Plutôt que de s’abrutir devant son écran de téléphone, il faudrait arriver à donner aux gens le goût des livres. Il y a quelque chose à faire, maintenant.
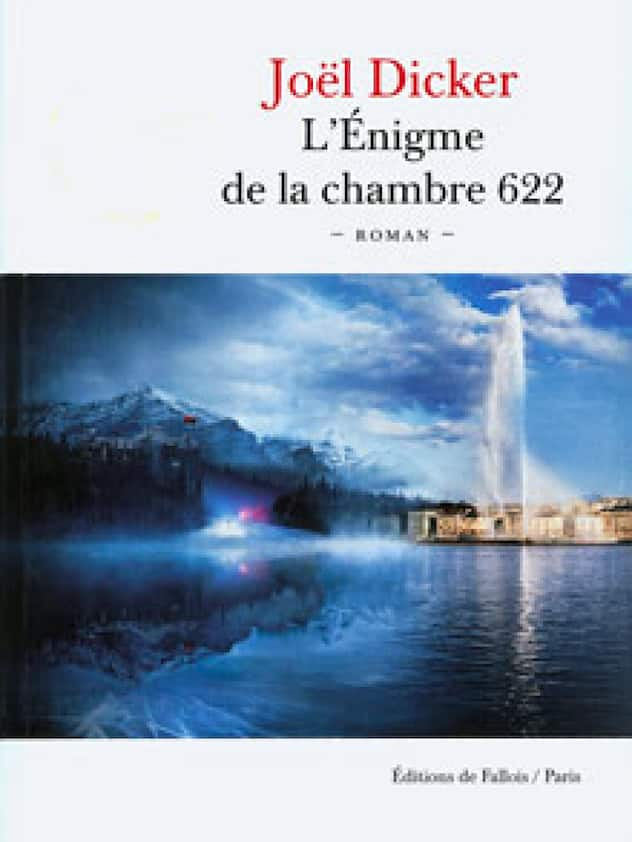
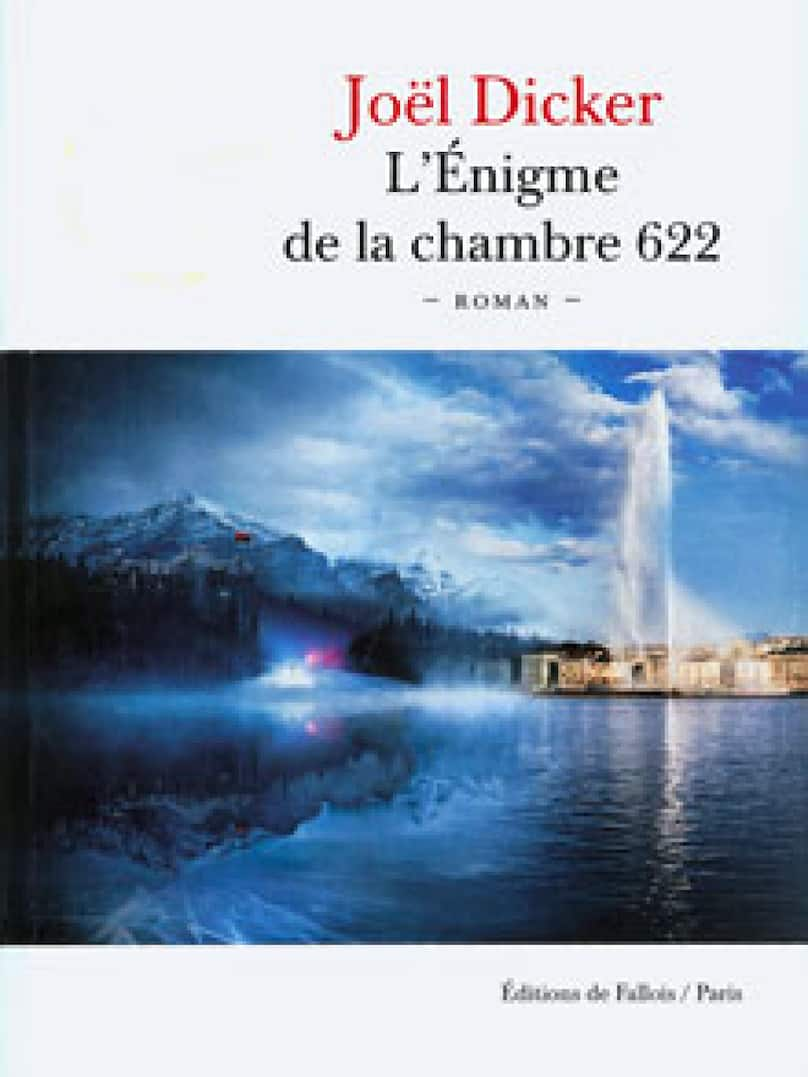
- Les gens sont accrochés à leur écran.
- On ne sait plus où l’on va. On dérive. On entend niaisement «J’ai lu sur Facebook que…» alors qu’on a accès à tous les plus grands journaux du monde. Si l’on est désinformé, ce n’est pas à cause des fake news: on est désinformé par soi-même. Que chacun l’assume et se dise: «Je clique sur des conneries à longueur de journée et je suis incapable de prendre de la distance avec ça.» Nous avons l’éducation et les outils, mais nous en sommes incapables, par paresse mentale probablement. La fake news, c’est nous.
- Cette responsabilité, on la retrouve aussi entre le citoyen et le politique.
- Il y a 70% de non-votants. Ces mêmes ne peuvent pas dire «Ces gens ne savent pas y faire!» en parlant de leurs responsables politiques autour du coronavirus par exemple. Est-ce que vous avez voté? Est-ce que les gens qui sont en place sont des gens que vous avez élus, directement ou indirectement? Si oui, c’est une chose. Mais si vous faites partie des gniolus qui ne sont pas allés voter, c’est de votre faute. Ne venez pas mettre en cause les décisions prises par des gens que vous n’avez pas désignés, en restant cloués devant la télé ou sur Facebook. C’est le problème: une fois encore, on a perdu le sens des responsabilités.
- La disparition de Bernard de Fallois a coïncidé avec votre paternité. Qu’est-ce que l’arrivée d’un enfant a changé en vous?
- Cette séparation et la paternité sont une étape importante de ma vie. La paternité m’a fait découvrir une force de vie plus grande encore. Mon existence est désormais passée au second plan. J’ai la responsabilité d’un enfant qui est incapable de se débrouiller seul. Cela remet beaucoup de choses en perspective. Pour moi, c’est prioritaire sur tout le reste.
- Vous allez bientôt* retrouver vos lecteurs. Que vous apprennent-ils?
- Je me rends compte qu’«Harry Quebert», c’était le succès à 27 ans. Les gens de cet âge-là me paraissent jeunes quand je les croise. J’ai 35 ans et ces huit ans de différence me frappent. Je vais entamer ma plus grosse tournée à travers 70 librairies en France, en Belgique et en Suisse. Mon éditeur s’en est étonné: «C’est quoi ce programme?» Moi, j’en ai envie. Au moment où je vous parle, je suis encore dans la phase de trac de l’artiste qui va entrer sur scène et qui se demande: «Mais comment ça va se passer?»
>> * Le livre de Joël Dicker devait sortir le 17 mars. L'auteur a décidé quelques jours avant de reporter l'événement à une date ultérieure pour cause de crise sanitaire. La nouvelle date de parution a été fixée au 19 mai.
>> Infos sur: www.joeldicker.com