Bonjour,
Joël Dicker: «Le livre est un miroir qui révèle nos secrets intimes»
A 36 ans, le romancier genevois au succès international Joël Dicker publie son sixième roman et boucle la trilogie «Harry Quebert». En parallèle, il lance sa maison d’édition. Mais ses préoccupations sont tournées vers le conflit ukrainien et notre incapacité à nous entendre, révélée pendant la pandémie. Rencontre autour de la fragilité des démocraties et de l’importance des livres dans un monde où domine le numérique.
Didier Dana

A 36 ans, le romancier genevois au succès international Joël Dicker publie son sixième roman et boucle la trilogie «Harry Quebert».
Anoush Abrar- Il y a deux ans, la sortie de votre livre a été retardée par le début de la pandémie. Cette fois, votre sixième roman, «L’affaire Alaska Sanders», paraît sur fond de guerre. Que peut la littérature?
- Joël Dicker: Ce que nous vivons est très effrayant. Pourquoi lire? C’est une grande question. Nous pourrions tout aussi bien passer nos journées sur TikTok, Twitter ou Instagram à nous insulter. On a découvert que, grâce à internet, on pouvait s’invectiver du matin au soir et être, chacun son tour, épidémiologiste, politologue, docteur ès lettres. En deux ans, on a réussi à se taper sur la tronche, pour ou contre les vaccins, pour ou contre le passe sanitaire. Ce que je retiens, c’est notre incapacité à faire front ensemble et notre capacité extraordinaire à nous diviser, à nous détester. On a toujours voulu croire que l’histoire nous permettrait de nous construire, d’être plus intelligents, plus cohérents, plus conscients de l’autre. Mais pas du tout.
- La littérature peut-elle nous sauver?
- La littérature peut nous sauver, si on le veut bien! Ce qu’elle peut, pour revenir à votre question initiale, c’est d’abord nous ouvrir l’esprit. Nous permettre une construction de nous-mêmes, nous rappeler l’importance de la réflexion: le livre est encore l’un des derniers bastions dans lesquels on est obligé de prendre du temps. Aujourd’hui, on entend partout: «J’ai lu sur Facebook que…» On voit passer un titre, tout en oubliant d’en vérifier les sources. Les réseaux sociaux sont devenus les premiers lieux d’information. N’oublions pas que l’avènement du digital nous permet d’avoir accès, en un seul clic, aux cultures du monde entier et à tous les grands journaux.

La bibliothèque de Joël Dicker contient des centaines d’ouvrages, dont quelques faux, parmi lesquels «G is for Goldman» et «The Origin of Evil» – avec l’image de l’acteur Patrick Dempsey au dos –, ainsi qu’une machine à écrire mécanique et une vieille coupure de presse. En réalité, des éléments de décor du tournage de la minisérie «La vérité sur l’affaire Harry Quebert», tirée de son roman à succès paru en 2012.
Anoush Abrar
La bibliothèque de Joël Dicker contient des centaines d’ouvrages, dont quelques faux, parmi lesquels «G is for Goldman» et «The Origin of Evil» – avec l’image de l’acteur Patrick Dempsey au dos –, ainsi qu’une machine à écrire mécanique et une vieille coupure de presse. En réalité, des éléments de décor du tournage de la minisérie «La vérité sur l’affaire Harry Quebert», tirée de son roman à succès paru en 2012.
Anoush Abrar- Quels ont été pour le jeune Joël Dicker les livres fondateurs?
- Le premier, c’est «La gloire», de Janusz Korczak. Mon grand-père, Vladimir Wolf Halpérin, me l’a offert lorsque j’avais 8 ou 9 ans. Je le garde précieusement dans ma bibliothèque. Il représente pour moi une connexion très forte avec le livre comme objet. Il est fondateur dans le sens de ce que peut représenter un ouvrage comme lien à l’autre, comme partage. Le livre est un cadeau qui n’est pas anodin. On oublie à quel point c’est un geste fort, parce qu’on raconte quelque chose de soi, parce qu’on construit aussi un pont avec l’autre.
- Cet ouvrage relate l’histoire d’enfants confrontés à la pauvreté, à la maladie et à la mort. L’auteur, un grand pédiatre, fut au fondement d’une pédagogie éducative.
- Il dirigeait l’orphelinat de Varsovie, en Pologne, où les droits des enfants et leur responsabilisation étaient un élément majeur. Ils n’y étaient pas assujettis à des adultes, bien au contraire. L’enfant était mis face à ses responsabilités, élevé à un niveau égal à celui des adultes. C’était un orphelinat de pensionnaires essentiellement juifs. Et, quand les Allemands sont venus pour les déporter, Korczak, qui était une figure connue et respectée, a refusé d’être épargné et a délibérément suivi ses jeunes protégés au camp de Treblinka. Mon grand-père avait fondé l’Association des amis suisses du docteur Korczak (ndlr: www.korczak.ch).
- Votre maison d’édition s’appelle Rosie & Wolfe. Un loup bondissant orne votre logo. Est-il aussi votre animal fétiche en littérature?
- Il est fétiche à plusieurs étapes de ma vie. «Le dernier loup d’Irlande», d’Elona Malterre, est un roman que je découvre vers 11 ans. Il est chargé de sens parce qu’il est l’ouvrage de la transgression. Je continuais à le lire une fois que mes parents éteignaient la lumière. Muni d’une lampe de poche et sous les couvertures, je voulais savoir. C’est un des premiers livres dont je me disais: «Que va-t-il se passer?»
- Une curiosité mêlée d’émotions?
- A la fin de l’histoire, je pleure. C’est un souvenir important, parce que je suis surpris de ma réaction. Je découvre que le livre est une machine à émotions. C’est un moment fort, car je me dis: «Voilà ce que peut faire un livre.» Et puis, le loup, c’est aussi Jack London, «Croc-Blanc», le Grand Nord qui m’a toujours attiré. Et enfin, «Le loup des steppes», roman initiatique de Hermann Hesse.
- Lisiez-vous des récits d’aventures?
- Oui, «Le comte de Monte-Cristo.» Il nous rappelle que la série télé – grand divertissement – n’a rien inventé. Les feuilletonistes comme Alexandre Dumas le faisaient bien avant. On a parfois oublié, je trouve, dans une littérature qui se veut parfois élitiste, l’idée même de divertissement. C’est devenu un gros mot, quelque chose de négatif. La fonction de divertissement du récit littéraire est une fonction salutaire indispensable. Elle permet une échappatoire à notre condition. Pendant des moments difficiles de notre vie, la maladie, une tragédie, des soucis ou l’enfermement qu’on a connu pendant le confinement. Et puis l’évasion, aussi, dans la période que nous traversons; quitter cette télévision qu’on allume à raison, parce que l’on aimerait savoir ce qui se passe, et échapper à cette ambiance de guerre très anxiogène. Le livre ne permet aucune inattention. On est dans le livre. Sans téléphone, sans télé, sans être en train de se parler.
- Qu’allez-vous publier chez Rosie & Wolfe?
- Pas plus de deux titres par an, parce que cela empiéterait sur mon temps d’écriture. L’an prochain, nous sortirons la version française de «Reader», «Come Home», de la neurologue Maryanne Wolf. Cet essai explique ce que c’est que la fonction de lire, ce qu’elle déclenche en nous. C’est un texte important à partager dans un monde numérique où l’on vit tous, moi le premier, avec l’abrutissement de la tentation du téléphone et l’impact de la technologie sur le cerveau. L’autre ouvrage, signé Patrick Marnham, s’intitule «War in the Shadows», ou «La guerre des ombres.» Il raconte un bout de l’histoire du SOE en France, les services secrets anglais, dont je parle dans «Les derniers jours de nos pères» (ndlr: paru en 2012). Marnham écrit sur les liens entre la résistance française, le SOE et les trahisons. Ce livre nous rappelle à quel point, même quand on est résistant et que l’on combat le nazisme, il y a parfois des guerres d’ego et des dissensions qui portent préjudice à la cause. Parce qu’on est comme ça, nous, êtres humains.
>> Lire aussi: Joël Dicker: «Je suis Suisse parce que ma famille a fui le nazisme»

Le romancier genevois a reçu son tout premier livre, «La gloire», de Janusz Korczak, des mains de son grand-père, Vladimir Wolf Halpérin. Wolf est aussi le prénom de son fils. En y ajoutant un «e», il en a fait l’une des deux composantes du nom de sa propre maison d’édition, Rosie & Wolfe.
Anoush Abrar
Le romancier genevois a reçu son tout premier livre, «La gloire», de Janusz Korczak, des mains de son grand-père, Vladimir Wolf Halpérin. Wolf est aussi le prénom de son fils. En y ajoutant un «e», il en a fait l’une des deux composantes du nom de sa propre maison d’édition, Rosie & Wolfe.
Anoush Abrar- Georges Simenon conseillait aux apprentis romanciers de ne pas lire quand ils écrivaient afin de ne pas être influencés. Est-ce votre cas?
- Au contraire. C’est bien d’être influencé. J’aime découvrir des mondes et si je ne lisais pas, la vie serait triste. J’ai aimé le thriller historique «1793», du Suédois Niklas Natt och Dag (ndlr. Ed. Sonatine, 2019). Il est l’essence de ce que peut être un livre. Rien ne me plaisait a priori. Ni l’époque, ni la couverture et encore moins le texte au dos de l’ouvrage. Il a des côtés violents, gore et c’est tout ce que je déteste. Pourtant, j’ai adoré. Il est génial parce qu’il me sort de ma zone de confort. Parce qu’il évoque plein de choses en moi, que c’est très dérangeant. Ce côté dérangeant, c’est nous-mêmes qui le sécrétons. La littérature nous renvoie des fantasmes, des peurs, des émotions profondément ancrées en nous. Le livre, en général, est un miroir. Il raconte quelque chose de nous, des secrets intimes qu’on partagera ou pas. C’est ça sa force.
- A la fin de «L’affaire Alaska Sanders», vos deux héros, Marcus Goldman et Perry Gahalowood, s’échangent un dossier: l’affaire Gaby Robinson. Serait-ce le titre du prochain Dicker?
- Non, pas forcément. Un livre à la fois, c’est déjà pas mal. Je pense à la suite, parce que je suis toujours en train d’écrire, mais quelque chose d’autre. Avec cette trilogie qui s’achève, une porte se referme. La vraie satisfaction, c’est de me dire: «J’ai réussi à aller au bout.» «Harry Quebert» se termine en 2009 et celui-là commence début 2010. Et, à la fin de ce livre, il se passe «Le livre des Baltimore» (ndlr: paru en 2015). Mon nouveau roman se termine quand Marcus part s’installer dans la maison de Boca Raton, petite ville de Baltimore. La boucle est bouclée.
- En dehors de la sortie de ce copieux ouvrage, vous lancez votre ambitieux projet d’édition. Est-ce une préoccupation supplémentaire?
- Les mots préoccupation et ambition me ramènent à une personne importante dans ma vie: mon grand-oncle Jean Halpérin, disparu en 2012. J’ai eu la chance d’aller déjeuner avec lui une fois par semaine. Notre rituel débuta vers l’âge de 5 ans, jusqu’à mes 27 ans. C’était une figure très importante, un homme de beaucoup de valeur, de tolérance, élégant et très cultivé, parlant neuf langues. Il a été patron de la traduction aux Nations unies. Votre question me rappelle ce qu’il me disait quand j’étais jeune. A la question «Ça va, Jean?», il me répondait: «(Soupir.) Ah, je suis préoccupé…» Je lui demandais pourquoi, pensant à sa santé. Il était préoccupé par la marche du monde. Je ne comprenais pas, puisque, en Suisse, tout allait bien. Comment pouvait-on être préoccupé par quelque chose d’aussi lointain? Aujourd’hui, quand on me demande quelles sont mes préoccupations, je pense immédiatement à la situation en Ukraine. Je suis très heureux de la sortie de mon livre et du lancement de Rosie & Wolfe, mais ma carrière n’est pas une préoccupation. Après la promotion, je disparais. Cette disparition me ramène à ma condition d’être humain. A cette exigence de devoir être tourné vers l’autre, ouvert, curieux et tolérant. Cela peut paraître très Bisounours, mais c’est vraiment ce que Jean Halpérin m’a véhiculé comme valeurs.
- A 36 ans, vous semblez mû par une urgence. Comme le souligne l’un de vos personnages: «Perdre son temps, c’est perdre sa vie.»
- Oui. J’y crois beaucoup. Dans les interviews, on me parle de succès et de chiffres de vente. Je comprends, mais je dois m’efforcer de rappeler qu’il y a aussi autre chose derrière mon projet: parler de la littérature et du combat pour le livre. Mais si l’on est dans une forme d’urgence, à mes yeux, aujourd’hui, c’est l’urgence de la démocratie. On se rend compte à quel point elle est fragile. Son sort est entre nos mains. On se rend compte, parce que l’Ukraine, dont le président Zelensky a été élu démocratiquement, est envahie et qu’on est à la porte de l’Europe, à quel point la démocratie est en danger chez nous aussi. Il faut se battre pour elle et ça commence par aller voter. La démocratie est faible quand la mobilisation dans les urnes l’est aussi. On est très fiers, moi le premier, du modèle démocratique suisse et de pouvoir raconter, à l’étranger, que nous votons quatre fois par an. Mais la réalité, c’est que ce modèle-là est affaibli. Moins d’un citoyen sur deux dépose son bulletin dans l’urne. Ne pas le faire, c’est cracher au visage de la démocratie, de ceux qui sont morts en 1940 et qui meurent en Ukraine en ce moment.
>> Lire aussi: La folle aventure de Joël Dicker et Jean-Jacques Annaud
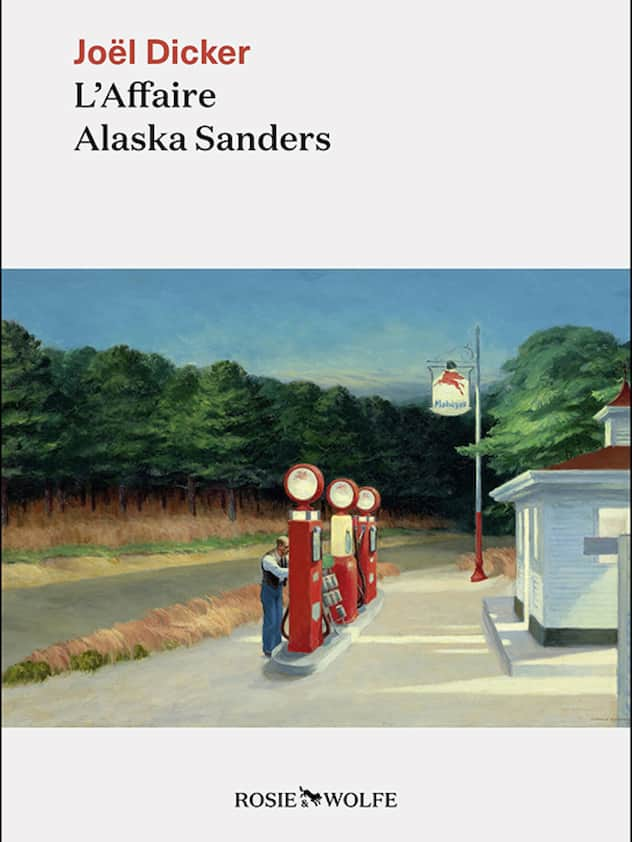
Découvrez ici «L’affaire Alaska Sanders» de Joël Dicker, Ed. Rosie & Wolfe, 570 p.
Rosie and Wolfe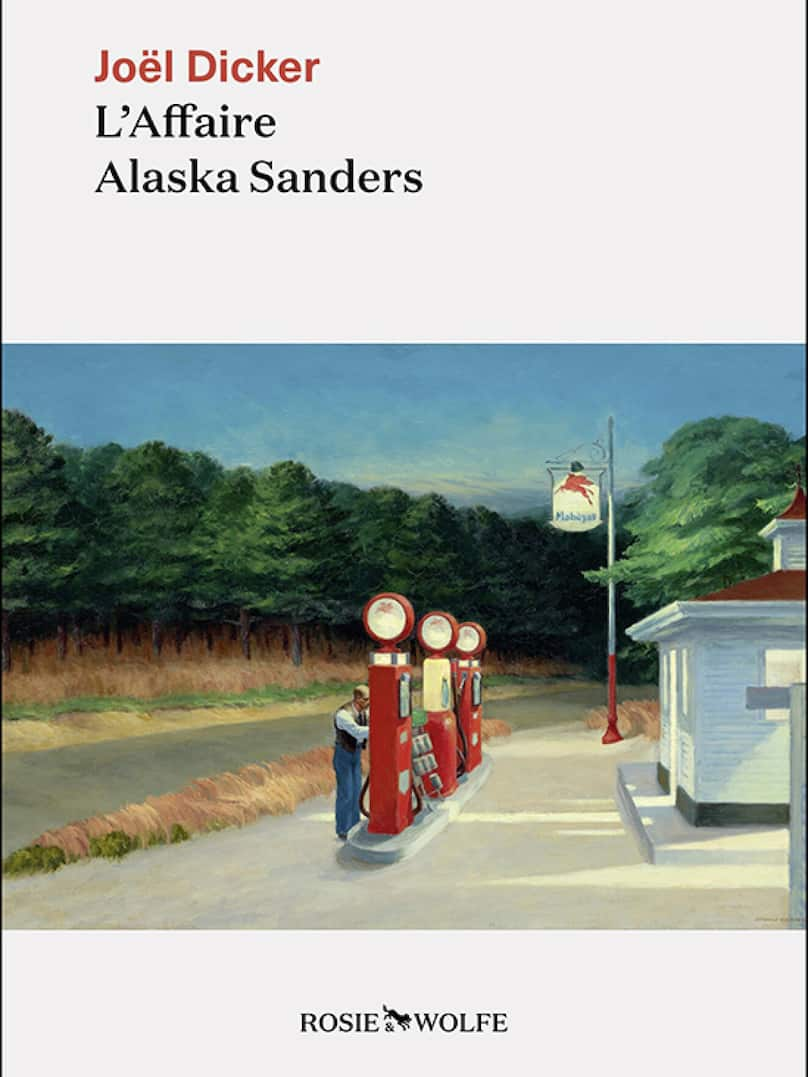
Découvrez ici «L’affaire Alaska Sanders» de Joël Dicker, Ed. Rosie & Wolfe, 570 p.
Rosie and Wolfe- On redécouvre, ces dernières semaines, que cette idée passe aussi par l’Europe unie, enfantée après la Seconde Guerre mondiale.
L’Europe, c’est ce bouclier. C’est la construction d’une grande démocratie qui passe par des consensus et aussi des difficultés et qui peut nous échapper à tout moment. La démocratie est à l’image de ceux qui la font. Ce ne sont pas les gouvernants, mais les électeurs, tous ceux qui peuvent voter et tous ceux – même les plus jeunes – qui n’ont pas encore le droit de vote mais qui ont une conscience politique et qui doivent l’utiliser. C’est le grand défi. On oublie trop souvent notre responsabilité individuelle. La démocratie, avant de la combattre, il faut la renforcer.
>> Découvrez ici «L’affaire Alaska Sanders» de Joël Dicker, Ed. Rosie & Wolfe, 570 p.
Alors qu’il se rendait sur le tournage de la série adaptée de son célèbre livre «La vérité sur l’affaire Harry Quebert», Joël Dicker manque de perdre le roman sur lequel il travaillait. Retour en 2017: l’écrivain genevois nous replonge dans son périple en avion durant lequel il a égaré le manuscrit de son cinquième ouvrage, pratiquement achevé.
Noemi Cinelli et Laetitia Béraud