Bonjour,
James Thierrée: «J’aime le chaos de la générosité»
L’artiste James Thierrée présente «Room» au Théâtre de Carouge. Une création sur laquelle il travaille depuis deux ans et dans laquelle la musique, la danse et le chant éclatent de mille feux, sans limites. Interview avec un homme habité par les arts de la scène.
Laurence Desbordes

James Thierrée prend la pose sous la dalle de ce que Jean Liermier, le directeur du théâtre, appelle le cœur ardent de ce nouveau lieu de spectacle, imaginé par le bureau d’architectes lausannois Pont12.
Anoush AbrarUne masse de cheveux gris au galop au-dessus de sa tête qui laissent présager la tempête créative qui règne dans son crâne, des yeux bleu glacier, une silhouette filiforme de poète qui se nourrit du geste, un pantalon rouge de clown rehaussé d’un t-shirt noir, rien n’est anodin chez James Thierrée. Même pas sa généalogie, qui en ferait rêver plus d’un mais qu’il a la modestie de ne pas porter comme une couronne. Attention, il ne la renie pas non plus pour autant car, tel un artisan, il la polit de son talent immense et l’orne çà et là, au fil de ses spectacles, de rubis, diamants et autres pierres précieuses. Mais laissons place plutôt à l’arrière-petit-fils du dramaturge Eugene O’Neill, au petit-fils de Charlie Chaplin et au fils de Jean-Baptiste Thierrée et Victoria Chaplin, deux illustres artistes circassiens. Ecoutons un homme qui préfère la beauté du mouvement à celle de la parole.
- Votre troupe s’appelle la Compagnie du Hanneton et votre premier spectacle se nommait «La symphonie du hanneton». D’où vous vient cet attrait pour ce coléoptère?
- James Thierrée: Le hanneton, c’est moi. Dans notre appartement parisien, à la fin des années 1970, je faisais beaucoup de bruit le matin pour traverser le couloir et aller de ma chambre au lit de mes parents, et, comme le hanneton, j’étais maladroit, je bourdonnais, m’accrochais aux cheveux, je me vautrais: mon père, qui a de l’humour, m’avait donné ce surnom. Quand j’ai monté ma compagnie, c’est venu comme ça, avec le titre de mon premier spectacle. C’était une sorte de profession de foi et une manière aussi de revendiquer un corps catastrophe qui est devenu ma carte d’identité sur scène. Il est toujours empêché, malmené par les objets, par les décors que je malmène moi aussi, mais sans aucun masochisme!
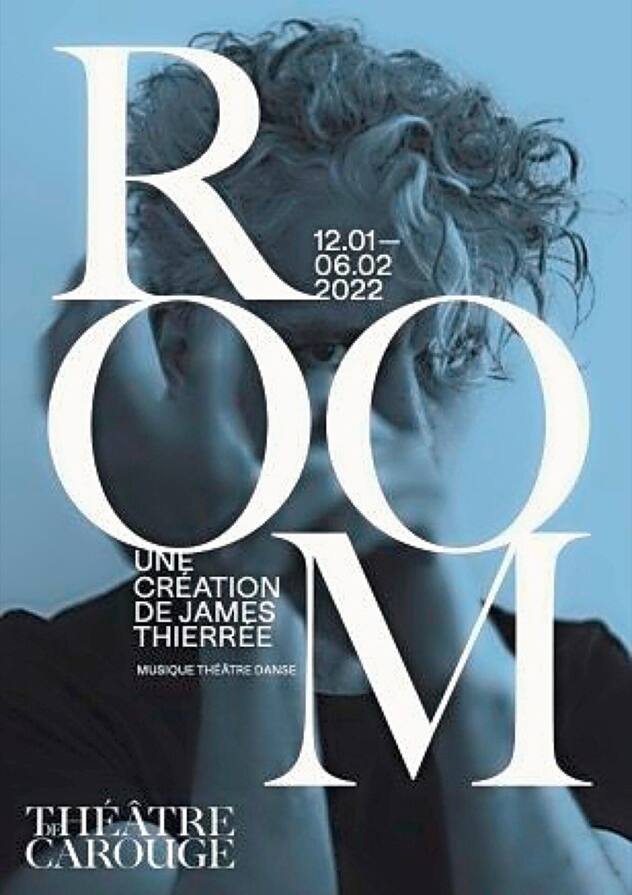
Tout a commencé il y a…Deux ans, avant que le covid n’entre en scène. Jean Liermier avait commandé une œuvre à James Thierrée. Puis le virus a fait son apparition. Mais dès le 12 janvier et jusqu’au 6 février, «Room» sera sous les projecteurs et sera suivi d’une très belle saison théâtrale 2022 à Carouge.
DR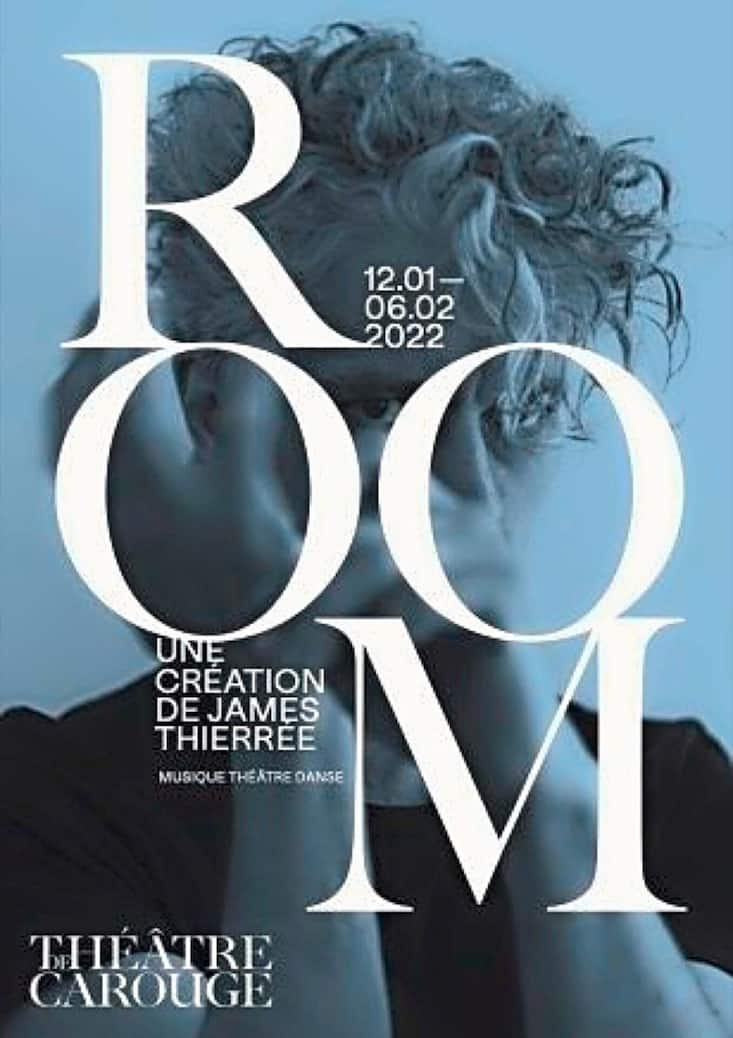
Tout a commencé il y a…Deux ans, avant que le covid n’entre en scène. Jean Liermier avait commandé une œuvre à James Thierrée. Puis le virus a fait son apparition. Mais dès le 12 janvier et jusqu’au 6 février, «Room» sera sous les projecteurs et sera suivi d’une très belle saison théâtrale 2022 à Carouge.
DR- Quand vous étiez petit garçon, vous viviez la plupart du temps aux côtés de vos parents dans le Cirque Bonjour qu’ils avaient créé. Vous réalisiez à cette époque-là que vous aviez une enfance exceptionnelle?
- Pas vraiment parce que, lorsqu’on est enfant, on est une éponge. On pense que le monde que l’on découvre, que l’on engrange est le vrai monde. Je regardais plutôt l’extérieur comme exotique et étranger. Les enfants qui allaient à l’école et menaient une vie sédentaire, je les trouvais passionnants. Les voyages, les villes qui se succédaient, les installations dans les théâtres, leurs atmosphères, leurs odeurs, leurs bruits et ce sentiment que tout bouge tout le temps, c’était ça, la maison.
- Vous aviez le temps de tisser des amitiés avec d’autres enfants?
- Un peu car, souvent, on faisait de longues séries et on s’arrêtait pour deux, trois semaines, voire un mois dans une ville. Cela permettait donc de rencontrer d’autres enfants. Bien sûr, parfois, il y avait de grands moments de solitude, mais cela va avec les plus. On est toujours nostalgique de quelque chose. Ceux qui ne bougent pas assez voudraient bouger plus et vice versa. Ensuite, c’est comment on transforme tout ça et comment on récupère cette énergie transmise par ses parents et qu’on y fait son nid, qu’on y mange et digère ce qui va nous servir plus tard dans la vie. J’ai beaucoup fait ça. J’ai absorbé, j’ai assez rapidement voulu essayer des choses parce que mes parents essayaient aussi des choses. Ils étaient dans une exploration théâtrale particulière, elle était autour du cirque mais c’était déjà un objet non identifié. C’est l’artisanat qu’on m’a transmis. Une forme d’exploration.
- C’est pour recréer le modèle familial de votre enfance qu’une fois adulte vous avez voulu créer une compagnie?
- Déjà, je préfère le mot troupe. La troupe au sens large, les artisanats du théâtre, la lumière, le son, la technique, c’est quelque chose qui me passionne parce que, évidemment, c’était mon environnement, mes premiers souvenirs. C’est devenu aussi mon langage théâtral et j’ai toujours eu envie de retrouver ces sensations-là. Sinon je ferais des solos. Cela serait plus rentable et plus simple sûrement (il rit), mais j’aime le chaos, le chaos du laisser-aller, de la nonchalance mais aussi de la générosité. C’est le chaos de «que sera, sera.»
- Vous avez aussi joué au cinéma et remporté un César en 2017 pour votre rôle du clown Foottit dans le film «Chocolat» avec Omar Sy. Une carrière au cinéma ne vous tente pas plus que ça?
- Ce sont deux univers qui se complètent. Parce que la subtilité du jeu d’acteur dans un gros plan où l’on ne doit pas faire tout ce que je fais sur scène, cette chimie de ramener l’intime, la sincérité, l’intention dans mon monde surréaliste corporel, totalement explosé dans ces formes, crée une chimie que je trouve intéressante vis-à-vis du public. Au cinéma, on n’est pas dans l’exploit, dans l’esbroufe, mais toujours dans une approche extrêmement réelle de l’artifice. J’aime beaucoup ça et le cinéma m’a beaucoup nourri, mais c’est sûr que mon centre de gravité est toujours ancré autour du grand navire du théâtre.
- Dès l’âge de 5 ans, vous jouiez aux côtés de vos parents une valise qui s’échappe. Vous vous êtes posé un jour la question de savoir ce que vous vouliez faire dans la vie, ou c’était une évidence?
- Oui, bien sûr. J’ai eu une période de flottaison, jeune homme, entre 18 ans et 24 ans. Je me suis posé plein de questions… On dit qu’il ne faut pas que tout coule de source. A un moment, dans l’existence, on a envie de savoir s’il n’y a pas autre chose qui nous ferait avancer. En revanche, je n’ai jamais eu envie de faire autre chose à l’extérieur du royaume artistique. Je n’ai pas vraiment été tenté de casser la ligne ancestrale et familiale. Et quand j’ai monté «La symphonie du hanneton», à 24 ans, cela a été une sorte de tsunami intérieur, comme si je devais rendre tout ce que j’avais accumulé lors de mon enfance. J’avais tout mis de côté, je ne pratiquais plus, j’essayais d’être acteur et de trouver ma place d’une autre manière. Puis le corps, la transformation est revenue. Tout comme ce que mes parents m’ont transmis. Ma mère faisait beaucoup de créatures, des numéros de transformation en costume – elle en fait toujours, d’ailleurs – et mon père créait des numéros autour de l’absurde; tout ça s’est retrouvé recyclé dans mon travail. En fait, je pense qu’on est tous faits de la même façon. On rend tout ce que l’on a accumulé d’une manière ou d’une autre.
>> Lire aussi: Culture: Les incontournables de 2022

L’artiste présente «Room» au Théâtre de Carouge. Une création sur laquelle il travaille depuis deux ans et dans laquelle la musique, la danse et le chant éclatent de mille feux, sans limites.
Anoush Abrar
L’artiste présente «Room» au Théâtre de Carouge. Une création sur laquelle il travaille depuis deux ans et dans laquelle la musique, la danse et le chant éclatent de mille feux, sans limites.
Anoush Abrar- Vous êtes un artiste pluridisciplinaire. Vous êtes acrobate, jouez du violon, vous dansez, vous mimez, etc. Qu’est-ce que vous ne savez pas faire?
- Je ne sais pas faire un budget, ni des travaux chez moi… (Il rit.) Je chante aussi, maintenant! J’ai cette espièglerie, cette arrogance des enfants qui essaient tout pour le plaisir.
- Votre corps, qui est votre instrument de travail, vous le traitez bien?
- Non, je le maltraite magnifiquement alors qu’il a 47 ans. J’ai connu des morts et des renaissances avec ce corps. A 32 ans, j’ai eu la sensation que c’était fini parce que l’acrobatie commençait à devenir compliquée, puis j’ai pris un autre virage, vécu une autre forme de compagnonnage avec lui, même si je lui demande énormément et qu’il me le donne tout le temps. Nous sommes un duo qui ressemble presque à celui de deux clowns, avec celui qui donne des coups et l’autre qui les reçoit et s’exécute. Evidemment, il y a toujours la facture au bout du couloir: les courbatures, les réveils douloureux. Mais face à la joie suprême d’avoir suivi l’idée originelle du spectacle, ce n’est pas si grave.
- Vous êtes toujours très laconique lorsque vous devez raconter un de vos spectacles…
- Oui, parce que, parfois, j’ai essayé d’aborder le thème mais c’est trop réducteur car ma première idée, un an avant la création, n’a finalement pas beaucoup à voir avec le résultat final. C’est un chemin de création et lorsque les spectateurs entrent en scène, le récit prend encore une forme différente de celle que j’avais imaginée. En fait, j’aimerais demander une seule chose au spectateur qui s’assoit, c’est qu’il ouvre son spectre d’acceptation et après qu’il vienne me raconter son voyage.
- Parlez-nous de «Room», votre dernière création pour le Théâtre de Carouge.
- C’est un spectacle avec dix artistes très orienté sur la musique et le corps. Il y a des musiciens et deux danseuses. Le projet a été percuté de plein fouet par ce virus que je ne nommerai pas, je ne lui ferai pas cet honneur, et a été repoussé d’un an. J’ai donc perdu une partie de mon équipe car il y a des gens qui ont changé de vie, de métier. A la base, «Room» était un projet qui respirait fort et voulait ne se donner aucune contrainte narrative. «Room», c’est ce qu’on veut, c’est une intimité, l’intérieur d’un crâne, c’est l’espace intérieur. C’est d’ailleurs lui, le personnage principal du spectacle. Il se refuse à sa destinée encadrée de chambre, il rue dans les brancards jusqu’à se désintégrer. Dans les tables de la loi de «Room», j’avais écrit quatre commandements en anglais. Vous aurez l’espace, vous serez dans la folie, vous creuserez jusqu’au cœur, vous serez libre de tout rationalisme préconçu. Ensuite j’ai dit aux artistes: «Voilà, ça, c’est la règle du jeu pour «Room.»
- Vos parents sont là aujourd’hui (jour de répétition), ils jouent dans votre pièce?
- Non, ils sont là pour soutenir le spectacle. Nous sommes très proches, nous avons vécu de grandes choses ensemble autour du travail.
- La transmission, c’est l’histoire de vos spectacles mais aussi celle de votre famille. Aimeriez-vous que cela continue avec votre fils, qui a 12 ans?
- Ce qui est beau dans certaines boutiques, c’est quand on voit «maison fondée en 1880». Mon fils, dès que je peux, je l’emmène. Il était là pendant les vacances de Noël. Il traîne dans le théâtre, et parfois, il vient me dire: «Je m’ennuie.» Je lui réponds: «Oui, c’est bien!» Car c’est le moment presque déterminant de l’enfance où l’on n’est plus amusé par les jouets extérieurs et tout à coup, c’est le jouet intérieur qui prend le relais, et construit un début de monde qui va être celui de notre âge adulte. L’ennui, c’est le début de quelque chose qui pointe son nez et chamboule. On ne s’ennuie plus assez aujourd’hui. Donc oui à la transmission, mais il faut qu’elle soit libre. Jamais mes parents ne m’ont dit: «Bon, alors tu vas le faire, ce numéro de trapèze!» J’ai eu envie d’être trapéziste comme j’ai eu envie de faire du violon. Après, c’est sûr que quand j’ai compris que cet instrument était infernal, j’ai voulu le reposer et là, ma mère m’a dit: «Non, tu persévères un peu quand même…»
>> Retrouvez «Room», de James Thierrée:
- Du 12 janvier au 6 février, Théâtre de Carouge, rue Ancienne 37, Carouge, 022 343 43 43, www.theatredecarouge.ch.
- 19 et 20 février, Théâtre du Crochetan, av. du Théâtre 9, Monthey, 024 475 79 09, www.crochetan.ch.
- 24 février, 20 h, Théâtre Equilibre, place Jean-Tinguely 7, Fribourg, www.equilibre-nuithonie.ch.
- Du 11 au 13 mars, Théâtre du Passage, passage Maximilien-de-Meuron 4, Neuchâtel, 032 717 79 07, www.theatredupassage.ch.